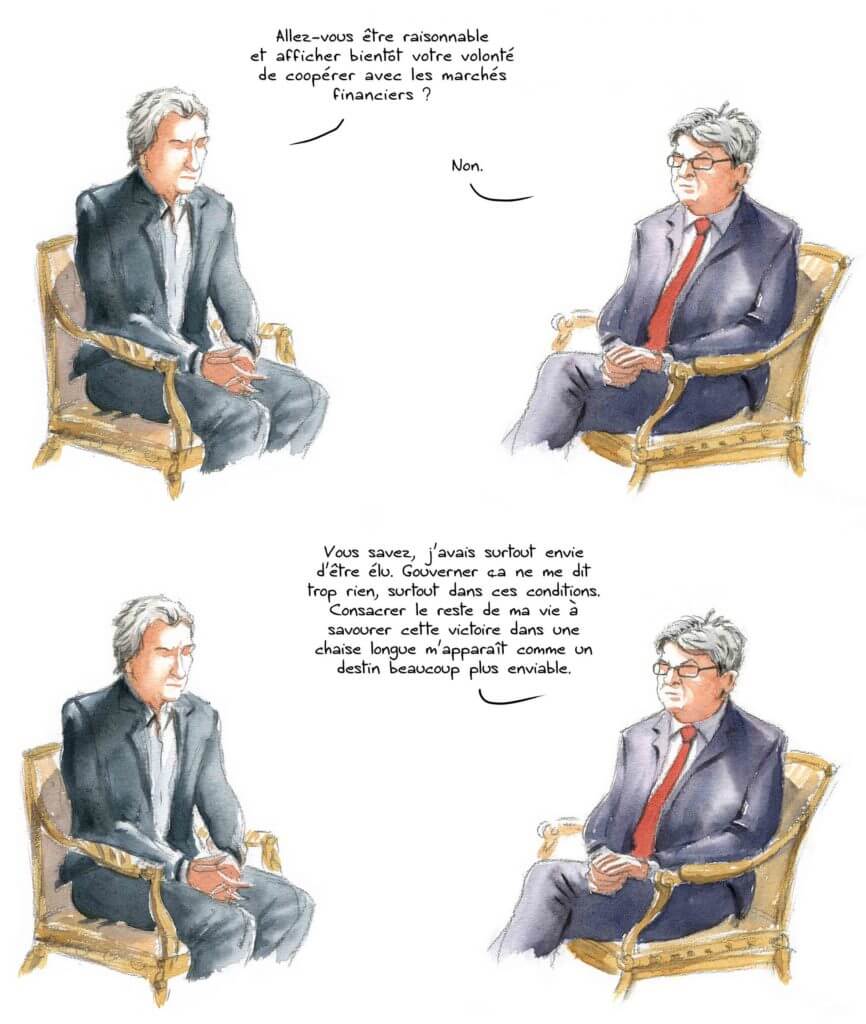Source : https://www.terrestres.org/2022/03/07/imaginer-experimenter-bifurquer-les-enseignements-du-passe/
Alessandro Pignocchi
Une stratégie classique pour rendre incontestable une domination consiste à la naturaliser sur la base d’un récit démontrant son caractère inéluctable. Le récit « évolutionniste » joue ce rôle pour la plupart des formes de domination que nous connaissons aujourd’hui : on peut bien les regretter, mais mieux vaut les accepter sagement car elles sont le résultat d’une immuable trajectoire évolutive. Trajectoire que connaissent toutes les sociétés humaines qui les mènent, après un certain nombre de stades intermédiaires, des clans de chasseurs-cueilleurs à l’État-Nation moderne.
Le dernier livre de l’anthropologue américain David Graeber (1961-2020) et de l’archéologue britannique David Wengrow, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, démonte ce triste scénario. Les auteurs montrent que l’histoire des sociétés humaines a été profondément foisonnante, avec de multiples expériences, bifurcations et hésitations où le choix délibéré et l’imagination politique ont joué un rôle central. La situation actuelle, présentée comme l’accomplissement d’un modèle unique et dans laquelle nous semblons bloqué·es, est toute contingente et n’avait rien d’inéluctable. Comment, alors, nous débloquer ?
La critique indigène et la réaction des Lumières
Face
au parallélisme que l’on ne peut s’empêcher de tracer entre notre
époque et les années trente, le dernier livre de Graeber et Wengrow
pourrait nous en souffler un autre, un peu moins sombre. L’analogie se
ferait cette fois avec la première moitié du 18e siècle et concernerait
le succès de ce que les auteurs appellent « la critique indigène ». Via
les récits des missionnaires, des aventuriers ou encore des
administrateurs, les occidentaux découvrent alors l’analyse que les
peuples autochtones faisaient de l’Europe. A l’époque, venue
principalement d’Amérique du Nord, cette critique était globale : elle
pointait la soumission des occidentaux à l’autorité, le manque de
liberté, d’entraide, et plus généralement l’apparente absurdité de leurs
institutions. Cette composante de la parole indigène s’est
malheureusement à peu près perdue aujourd’hui, pour laisser la place à
un discours focalisé sur nos relations à la « Nature » ou, plus
précisément, sur notre rapport purement utilitariste et destructeur aux
vivants non-humains. Graeber et Wengrow ravivent cette première
composante de la critique indigène du 18e siècle, qui n’a rien perdu de
son actualité, bien au contraire, et sans laquelle le discours sur la
Nature ne saurait avoir la moindre efficacité politique.
Graeber
et Wengrow montrent à quel point l’impact de la parole indigène a été
fondamental sur les Lumières, et à quel point il a été par la suite
minimisé. Dans les salons parisiens, on se passionnait pour les récits
des jésuites horrifiés par la liberté dont jouissaient les indiens, et
les ouvrages du type « dialogue avec un sauvage » étaient d’immenses
succès de librairie. Les européen·nes découvraient en effet des peuples
qui prenaient leurs décisions politiques au consensus, et pour qui les
facultés d’argumentation, d’écoute et tout ce qui favorisait la décision
collective étaient érigés au rang de valeurs suprêmes. Au contact de
leurs envahisseurs, les indien·nes d’Amérique du Nord ont employé ces
qualités pour construire une critique articulée du monde qu’ils
découvraient.
Graeber et Wengrow nous présentent notamment
Kondiaronk, un indien Huron-Wendat particulièrement brillant qui était
régulièrement invité pour débattre à la table du gouverneur de la
Nouvelle-France, qui s’est certainement rendu en France comme
ambassadeur de la Nation Wendate et dont les propos sont consignés dans
les quatre tomes des Dialogues de Lahontan. Kondiaronk y file l’idée
d’après laquelle les institutions françaises semblent faites pour
stimuler les plus mauvais penchants de la nature humaine : « Ô quel
genre d’homme sont les Européens ! Ô quelle sorte de créatures ! Qui
font le bien par force, et qui n’évitent à faire le mal que par la
crainte des châtiments ? » (p. 77). Il exhorte les français·es à adopter
les institutions wendates et leur assure qu’après une petite période
d’adaptation, au cours de laquelle ils seront certainement un peu
désorientés, ils trouveront la vie bien plus joyeuse, épanouissante et
exaltante. Ses arguments sont d’abord centrés sur la liberté
individuelle, une notion qui n’allait pas du tout de soi, loin de là,
pour les européens de l’époque. Il montre ensuite que celle-ci ne peut
être assurée que par des institutions qui encouragent un fort niveau
d’entraide spontané, et donc une certaine forme d’égalité.
Graeber
et Wengrow soulignent que les concepts même de liberté, d’égalité et de
fraternité n’auraient pas pu être pensé, du moins pas de la manière
dont ils l’ont été, sans le choc qu’a constitué pour les occidentaux la
confrontation avec des modes d’organisation sociale aussi radicalement
autres1 Pour une analyse critique de cette thèse voir la recension de
David A. Bell
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/12/03/une-histoire-imparfaite-de-lhumanite/.
Le questionnement concernant l’origine des inégalités apparaît
également en réaction à la critique indigène. Et, d’une certaine façon,
ce fut la première brique qui permit aux européen·nes de la neutraliser.
En effet, formulée ainsi, la question commence à ordonner les choses
sur un axe historique et ouvre la voie aux scénarios évolutionnistes :
il y a eu une eden égalitaire, et puis les inégalités sont
(inéluctablement) apparues. La morale plus ou moins tacite des scénarios
évolutionnistes qui ont depuis envahi la pensée occidentale est en
substance la suivante : les indien·nes sont peut-être plus libres que
nous, mais c’est parce qu’ils en sont à un stade inférieur de
développement ; leur critique est pertinente, mais à la manière dont
peut l’être le regard d’un enfant sur le monde des adultes. Or il faut,
et c’est bien triste, grandir. Les sociétés sont contraintes elles aussi
de se développer et, ce faisant, elles voient nécessairement apparaître
les inégalités que nous connaissons.
Ce récit évolutionniste
occupe encore largement le sens commun aujourd’hui et se retrouve dans
des livres de vulgarisation comme ceux de Yuval Noah Harari ou de Jared
Diamond. L’idée directrice est que, poussées par une force mystérieuse,
les sociétés humaines sont condamnées à toutes évoluer selon la même
trajectoire. Aux clans de chasseurs-cueilleurs qui gambadent dans la
savane avec une insouciance juvénile succèdent les tribus, puis les
chefferies, qui elles-mêmes évoluent inexorablement vers les royaumes,
les empires et l’État moderne. L’évolution des moyens de subsistance est
enchevêtrée dans cette histoire des formes d’organisations sociales :
les chasseurs-cueilleurs se mettent à faire de l’horticulture et de
l’élevage avant d’être bouleversés par la « révolution agricole ».
Celle-ci crée la propriété foncière et d’importants surplus, et donc un
pouvoir coercitif pour les protéger ainsi qu’une bureaucratie pour les
gérer. La porte est alors ouverte à une société de plus en plus
hiérarchisée et inégalitaire, et finalement l’avènement de la
civilisation industrielle.
Choix politiques et oscillations saisonnières
L’ensemble
du livre de Graeber et Wengrow démonte ce lieu commun fortement
enraciné dans nos imaginaires. Les auteurs montrent que l’histoire des
sociétés humaines a été beaucoup plus touffue, chatoyante et désordonnée
que ce qui est habituellement raconté. Surtout, le choix réfléchi et
conscient y a joué un rôle au moins aussi important que les
déterminismes environnementaux de tous ordres. Les humains ont fait
preuve d’une imagination politique débridée, ils n’ont jamais été des
automates poussés par une force évolutive dont ils ignoraient tout.
Leurs
choix collectifs concernant la façon dont ils désiraient vivre ont
nourri toutes sortes de bifurcations, d’oscillations et de créations
inattendues. Ces choix étaient alimentés par de complexes jeux
d’imitation et de rejet vis-à-vis d’autres sociétés, parfois très
éloignées géographiquement, par la mémoire de leur propre histoire
jalonnée d’expérimentations joyeuses ou traumatisantes et par
l’expérience directe, lors de rituels et de fêtes qui déstructuraient
l’ordre social et, surtout, lors d’oscillations saisonnières au cours
desquelles tant l’organisation politique que les modes de subsistance
pouvaient se reconfigurer du tout au tout.
Pour construire leur
argument, Graeber et Wengrow s’appuient sur une immense synthèse des
données archéologiques les plus récentes, des données qui étaient
jusqu’à présent restées dispersées dans les cercles de spécialistes.
Leur mise en regard et leur confrontation avec une foule de données
anthropologiques permet aux auteurs de dessiner un impressionnant
panorama d’ensemble. Il est rigoureusement impossible en une recension
de rendre justice à la richesse et au foisonnement de ce livre. Le tri
opéré ci-dessous dans les arguments et les exemples est en grande partie
arbitraire et ne vise qu’à donner une vague idée du déroulé.
Le
scénario évolutionniste déraille dès le paléolithique. L’image d’une
terre uniquement peuplée de petits clans indépendants les uns des autres
est mise à mal par la sophistication de certaines sépultures
découvertes dans une grande partie de l’Eurasie occidentale, dont les
plus anciennes ont 34 000 ans. Celles-ci contiennent des artefacts ayant
demandé des milliers d’heures de travail, peut-être avec un certain
degré de spécialisation artisanal et emploient des matériaux et des
savoir-faire ayant voyagé sur de très grandes distances. Le fait que la
majorité de ces rituels funéraires semblent avoir concerné des personnes
possédant des difformités et des particularités physiques demeure un
mystère, même si le rapprochement avec des données anthropologiques
permet aux auteurs d’énoncer des hypothèses sur le rôle de
l’excentricité. Les premières traces de pratiques culturelles d’une
complexité et d’une diversité incompatibles avec l’image classique
risquent par ailleurs fort d’être encore largement repoussées dans le
passé, dans la mesure où les découvertes archéologiques dans certaines
régions du monde – dont l’Afrique – n’en sont qu’à leur début.
La
vision évolutionniste du paléolithique explose littéralement face à la
découverte de vestiges de constructions architecturales monumentales,
comme les enclos du site de Göbekli Tepe en Turquie, vieux de 9 000 ans,
composés de monolithes richement sculptés et modifiés au fil des
siècles, ou les constructions circulaires en os et en défenses de
mammouth qui apparaissent entre 25 000 et 12 000 ans avant notre ère en
Europe de l’Est. Ces constructions ont nécessité une conception
minutieuse et une grande coordination des tâches. Les indices qu’elles
recèlent indiquent qu’elles étaient destinées à accueillir d’immenses
rassemblements saisonniers. Avec la fin de l’ère glaciaire, ces œuvres
monumentales se multiplient, notamment en Amérique du Nord et au Japon.
Le site de Poverty point, érigé vers 1600 avant notre ère en Louisiane,
est une enceinte de plus de 200 hectares entourée d’immenses tertres.
Ces constructions suivent des principes géométriques que l’on retrouve à
l’identique dans toute la vallée du Mississippi et au-delà, jusqu’au
Mexique et au Pérou, suggérant une circulation des savoirs à très grande
échelle. La grande diversité des objets qui affluaient périodiquement à
Poverty Point, avec des milliers de personnes, semblait destinée à une
intense activité rituelle.
Les auteurs rapprochent ces
découvertes archéologiques et des données anthropologiques concernant
des peuples, comme les Nambikwara, les Inuits, les Kwakiutls, les
indiens des plaines et bien d’autres, qui eux aussi organisaient leur
existence autour d’oscillations saisonnières, des cycles de
rassemblement et de dispersion qui étaient l’occasion d’un profond
changement de vie. Ces peuples disposaient d’une « double morphologie »,
comme l’écrivait Marcel Mauss, qui permettait par exemple aux Inuits
d’avoir « deux structures sociales, une d’été et une d’hiver », et donc «
deux droits et deux religions » (p. 142). Pendant des dizaines de
milliers d’années, ces transformations annuelles, qui se sont maintenues
pour certains peuples jusqu’à très récemment, semblent avoir été la
règle. Des transformations qui concernaient tant l’organisation sociale,
les modes de subsistance, les activités pratiquées que les jeux de
valeurs collectivement acceptés.
Aucune régularité ne permet par
ailleurs de se raccrocher à une forme ou une autre d’évolutionnisme.
Les grands rassemblements se faisaient parfois l’été, parfois l’hiver,
ils pouvaient s’accorder avec les déplacements du grand gibier, les
migrations des poissons, la fructification des fruits à coque ou la
possibilité de pratiquer une forme d’horticulture. Toutes les
combinaisons étaient par ailleurs possibles dans les transformations de
l’organisation sociale. Parfois les grands rassemblements étaient très
égalitaires tandis que les périodes de dispersion connaissaient des
formes de hiérarchie, parfois c’était l’inverse et parfois les deux
périodes de l’année étaient égalitaires ou hiérarchisées mais selon des
modalités bien différentes.
Autrement dit, certains peuples
bondissaient en cours d’année d’une extrémité à l’autre du spectre
évolutionniste, petits clans égalitaires de chasseurs-cueilleurs en été
et sujets d’une vaste structure de type étatique en hiver, tandis que
d’autres peuples en parcouraient en tous sens les différentes étapes.
Les Nambikwara formaient des villages égalitaires pour pratiquer
l’horticulture, et adoptaient de petites structures hiérarchisées
lorsqu’ils se dispersaient, tandis que les Cheyennes et les Lakotas
composaient, lors de leurs immenses rassemblements, une « police du
bison », dotée d’un fort pouvoir coercitif, et destinée à assurer la
bonne coordination des grandes chasses et le bon déroulement des rituels
qui s’ensuivaient. Une police qui se dissolvait avec la dispersion,
pour se reconstituer l’année suivante, mais avec les membres d’un autre
clan, si bien que toute personne au cours de sa vie était amenée à
exercer le pouvoir coercitif et à le subir. Dans les termes des auteurs,
le passé de l’humanité ressemble « bien plus à un défilé de carnaval où
paradent toutes les configurations politiques imaginables qu’aux mornes
abstractions de la théorie évolutionniste. » (p. 157).
À la
lecture de ces pages, nous nous sentons tristement bloqués dans un ordre
social et technologique que nous n’avons pas choisi. Il reste dans nos
sociétés des résidus de variations saisonnières comme, en France, les
grandes vacances d’été, mais avec une ampleur si minimale qu’elles ne
peuvent aucunement nous conférer la profondeur politique que devaient
posséder des peuples expérimentant dans leur chair des métamorphoses
beaucoup plus radicales. Celles et ceux d’entre nous qui ont eu la
chance de changer de vie pendant une période relativement longue, par
exemple à l’occasion d’une année sabbatique, savent que même les
composantes de soi que l’on croyait les plus immuables se transforment,
au point que l’on pourrait être tenté de changer de nom, comme le
faisaient les Kwakiutl au moment des transitions entre dispersion et
rassemblement. Au-delà de la maturité politique, on ne peut qu’imaginer
avec envie l’état d’euphorie et d’exaltation que devait connaître des
personnes se rendant, avec leur petit groupe, à un grand rassemblement
annuel, au cours duquel elles allaient participer à des parties de
chasses exaltantes, se mêler à une socialité liée à des pratiques
horticoles, participer à la construction de somptueuses œuvres
architecturales avec des centaines de personnes ou encore se mêler à une
foisonnante vie rituelle et magique.
Les évolutionnistes2Les «
évolutionnistes » en anthropologie sont désormais en grande partie des
hommes de paille. Plus personne ou presque ne défend ce scénario sous sa
forme première. Alain Testart, notamment dans Les chasseurs-cueilleurs
ou l’origine des inégalités (Paris, Société d’Ethnologie, 1982), discute
du phénomène de cliquet introduit par la pratique du stockage, mais
cette forme d’évolutionnisme très nuancé est relativement indépendante
de la critique de Graeber et Wengrow. En revanche, dans le sens commun
et dans les ouvrages de vulgarisation, l’évolutionnisme des origines
reste la théorie dominante. ont pris comme modèle pour l’aube de
l’humanité les populations de chasseurs-cueilleurs qui subsistaient
encore au XXe siècle, dans les rares endroits inhospitaliers qu’on leur
avait laissés, comme le cercle polaire ou les déserts africains. Avec un
ton espiègle qui court tout au long de l’ouvrage, Graeber et Wengrow
remarquent qu’il est étonnant que les chasseurs-cueilleurs du
paléolithique, à l’époque où la terre n’était qu’à eux, se soient
installés délibérément dans les endroits les plus hostiles et aient
délaissé les rives des grands fleuves, les deltas et toutes les zones
les plus giboyeuses et les plus fertiles. Tout aussi surprenante aurait
été l’absence totale d’expérimentation politique et sociale pendant
plusieurs dizaines de milliers d’années.
Grandes villes égalitaires, petits royaumes perchés et agriculture en dilettante
Les
évolutionnistes pourraient répondre que, certes, ils ont sans doute
sous-estimé la complexité des premiers temps, mais que dès que ces
grandes structures saisonnières devenaient pérennes, comme des villes
modernes ou, plus généralement, dès que la population se densifiait de
façon durable, alors leur scénario reprenait ses rails et menait
inexorablement aux hiérarchies sociales stabilisées, aux despotes, à la
société industrielle et aux élections tous les cinq ans. Là encore,
cette histoire est sans rapport avec ce que dit l’archéologie. Les
vestiges de Çatal Höyük en Turquie, considérée comme la plus ancienne
ville connue, ne semblent révéler aucune forme de stratification sociale
ni de pouvoir centralisé sur les mille cinq cent ans de son histoire,
de – 7 400 ans à – 5 900 ans.
Les grandes villes plus tardives
des plaines mésopotamiennes, comme Uruk, étaient également plutôt
égalitaires. Des formes d’égalitarisme qu’elles maintenaient
généralement en place grâce à une bureaucratie complexe. Ce sont au
contraire les petites sociétés des plateaux et des steppes environnantes
qui s’apparentaient à des royaumes. Leurs monarques fondaient leur
pouvoir sur un charisme acquis par des exploits guerriers et sportifs,
et rejetaient violemment tant l’égalitarisme que la bureaucratie des
plaines. Ce contraste relève d’un jeu de distinction sociale à grande
échelle, que Graeber et Wengrow nomment « schismogenèse », et qui opère
tout au long de l’histoire des sociétés humaines. Une logique
contrastive qui s’étendait jusqu’aux systèmes de valeurs : à la
valorisation des pratiques plutôt liées aux femmes, notamment agricoles,
dans les plaines, répondait une glorification des valeurs viriles liées
à la chasse et à la guerre sur les plateaux – même si, pour leur
subsistance, ces populations commerçaient entre elles et dépendaient
toutes deux d’un mélange complexe entre pratiques agricoles et
exploitation des ressources sauvages.
Les grands centres urbains
explorant différentes formes d’égalitarisme et différents modes de
prise de décision démocratique se retrouvent, sous de multiples formes
et avec autant de trajectoires particulières, partout dans le monde et à
toutes les époques. Même Teotihuacan (Mexique), dont le nom suffit à
évoquer aux lecteurs naïfs comme moi des images de caciques tatoués
arrachant les boyaux de leurs sujets, a été égalitaire pendant la plus
grande partie de son histoire. Lors de ses cent premières années,
Teotihuacan semblait s’engager sur la voie menant à une aristocratie
guerrière concentrant tous les pouvoirs. Mais sa population a
soudainement bifurqué pour s’engager dans un « incroyable programme de
logement social » (p. 429). Le temple de Quetzacóatl fut profané et les
sacrifices humains autour des pyramides de la lune et du soleil ont
cessé, tandis que la ville se couvrait de complexes résidentiels logeant
chacun entre 60 et 100 personnes dans de confortables habitations en
dur organisées autour de cours centrales. Et ce sans qu’aucune élite
gestionnaire ne coiffe les conseils de quartier dont les lieux
d’assemblée étaient disséminés dans toute la ville.
L’organisation
démocratique de Teotihuacan est loin d’être une exception. Elle se
retrouve entre autres dans des cités plus tardives pour lesquelles
existent des récits de visiteurs européens, comme Tlaxcala, qui abritait
au moment de la conquête 150 000 personnes. Les décisions politiques y
étaient prises à l’unanimité par un conseil dont les membres étaient
sélectionné·es pour leurs qualités d’autodérision et leur capacité à
supporter l’humiliation, et qui devaient subir une série d’épreuves
visant à leur « mettre l’ego en miettes » (p. 451).
L’agriculture,
quant à elle, n’est pas du tout apparue subitement, transformant
irréversiblement la vie sur terre, comme le suggère l’expression
classique de « révolution agricole ». Des pratiques agricoles sont
apparues dans de multiples endroits et se sont mêlées organiquement aux
pratiques de subsistance fondées sur les ressources sauvages, avec
toutes sortes d’intermédiaires possibles, sans les dominer ni les
remplacer. Ce fût notamment le cas dans la région du fameux croissant
fertile pendant trois-mille ans, ce qui est long pour une révolution. À
Çatal Höyük, on pratiquait une agriculture de décrue qui demandait peu
de travail et qui, soit dit en passant, était incompatible avec la
propriété foncière puisque les sites de plantation changeaient chaque
année. On n’y a en revanche pas domestiqué les bœufs et les cochons
comme cela se faisait dans des régions avec lesquelles Çatal Höyük
entretenait d’importants échanges : on préférait chasser leurs
équivalents sauvages.
À l’inverse, en Grande-Bretagne vers 3300
avant J.-C., la céréaliculture a été abandonnée au profit de la récolte
de noisettes, tout en conservant les cochons et les bovins domestiques,
peut-être parce que ce mode de subsistance était plus compatible avec
les grands déplacements saisonniers, ou pour toute autre raison qui
semblait rendre la vie plus agréable. Les motivations pour adopter des
pratiques agricoles ne relevaient d’ailleurs pas nécessairement de la
subsistance. Elles pouvaient être liées à la forme de socialité que ces
pratiques sous-tendaient, ou à des raisons rituelles et festives, comme
sur les toits grecs dans les « jardins d’Adonis ». Les récits
évolutionnistes se demandent souvent pourquoi l’agriculture a « échoué à
gagner » telle ou telle région qui lui était pourtant favorable
(p.322). Les hypothèses imaginées évoquent généralement des subtilités
environnementales, quand la raison tient au fait que les peuples qui
habitaient ces régions avaient choisi sciemment de se passer
d’agriculture, ou d’adopter des formes hybrides, en fonction de ce
qu’ils considéraient, pour de multiples raisons, comme les bons choix de
vie.
On voit ce que l’on connaît
Graeber
et Wengrow, avec une évidente délectation, parsèment leur démonstration
de méta-remarques sur le monde de la recherche. Ils notent par exemple
avec quelle aisance les universitaires, biberonnés à la hiérarchie et au
patriarcat, ignorent tout ce qui ne correspond pas à leurs attentes.
Ainsi, dans une aire donnée, par exemple l’Égypte ancienne ou la société
Maya, les périodes égalitaires, ou plus généralement celles qui
illustrent des modes d’organisation difficilement compatibles avec leur
scénario pré-écrit, se voient rangées sous des concepts tels que «
période archaïque », « période de transition », « âges sombres », « pré-
», « proto- » ou « post- » quelque chose.
Les cités
ukrainiennes néolithiques se voient qualifiées de « megasites », ou de «
villages surdimensionnés », mais pas de « villes », sans doute parce
qu’on n’y trouve pas de trace de hiérarchie ni de pouvoir centralisé.
Pour la même raison, leur organisation est qualifiée de « simple » :
pour devenir « complexe », il leur faudrait des chefs, alors qu’on
imagine bien à quel point ça ne devait pas être simple de maintenir un
fort égalitarisme entre plus de dix-mille personnes. Leur mode de
subsistance reposait par ailleurs sur un patchwork d’importations, de
pratiques agricoles, de chasse et de cueillette qui nécessitait sans
doute une logistique minutieuse. La ville de Taosi, en Chine, après des
débuts marqués par une forte stratification sociale, et à la faveur de
ce qui s’apparente à une révolution deux mille ans avant notre ère, a
connu plusieurs siècles d’égalitarisme. Les archéologues en ont dit
qu’elle « avait perdu son statut de capitale et était en proie à
l’anarchie » (p. 415), « au chaos », qu’elle avait subi un «
effondrement » (p. 416), alors même que sa population a augmenté pendant
cette période. Le point culminant du ridicule est atteint par un
chercheur travaillant sur la société minoenne et qui, alors même que
toutes les données montrent que le pouvoir politique était exercé par
des assemblées collégiales de femmes, tente d’expliquer que la forme du
siège central semble tout de même « mieux convenir à un homme ». Quant à
la seule statuette masculine découverte lors des fouilles, elle a
immédiatement été qualifiée de « prince ».
Le pouvoir centralisé
autoritaire et patriarcal est pris comme le mode d’organisation par
défaut, faisant porter la charge de la preuve sur celles et ceux qui
cherchent à démontrer son absence, alors même que les chefs autoritaires
laissent en général beaucoup plus de traces que les systèmes politiques
égalitaires. En l’absence de telles traces, l’attitude spontanée
consiste à dire qu’elles ont dû disparaître, à moins que l’on ne
qualifie la société correspondante d’exception ou de pré- quelque chose.
C’est que, comme « les universitaires ne font que très peu, voire
jamais, l’expérience de la prise de décision démocratique, ils ont du
mal à envisager cette possibilité pour d’autres » (p. 407).
Les
tenants de l’évolutionnisme tiennent par ailleurs à ce que la démocratie
ne soit apparue qu’une seule fois, en Grèce, comme une sorte de
miracle, alors que des formes d’auto-gouvernance, y compris à très
grande échelle, des modes de prise de décision démocratique et des
formes d’organisation sociale explorant différents types d’égalitarisme
se retrouvent dans toutes l’histoire humaine et sur tous les continents.
Ces systèmes étaient d’ailleurs souvent nettement plus égalitaires que
l’expérience grecque qui excluait de la prise de décision les femmes,
les étrangers (jusqu’à 30 % de la population) et les esclaves (40 % de
la population).
Les évolutionnistes ont une dernière carte :
certes l’histoire a été un peu plus chaotique que ce que nous avons
l’habitude de raconter, mais après quelques vaines cabrioles l’humanité a
fini par retomber sur ses pattes, c’est-à-dire sur l’État moderne et
son cortège de pouvoir coercitif, de hiérarchies et d’inégalités.
L’histoire de l’Amérique du Nord, brutalement interrompue par la
conquête, prouve le contraire. Le continent, aux alentours de l’an 1000,
a connu le développement de grands centres urbains dotés d’un pouvoir
centralisé, héréditaire et fortement coercitif (par exemple à Cahokia,
dans la vallée du Mississippi). Ces villes ont fini par être démantelées
ou simplement abandonnées, et les zones qu’elles occupaient, comme un
symbole, ont par la suite été soigneusement évitées. Ces expériences
traumatisantes ont marqué l’histoire politique du continent, si bien que
les institutions qui se sont développées par la suite ont souvent été
pensées pour en prendre le contre-pied et éviter qu’elles ne se
reproduisent. Kondiaronk, cet indien Huron-Wendat que nous avons
rencontré au début de l’ouvrage, portait donc sur les institutions du
vieux-continent un regard qui, loin d’être enfantin, était façonné par
cette longue et complexe tradition de philosophie politique.
Libertés fondamentales et formes de domination
Pour
s’y retrouver dans ce jubilatoire foisonnement d’expérimentations,
Graeber et Wengrow proposent de distinguer trois libertés fondamentales
et trois formes de domination. Les trois libertés sont la liberté de
fuir, de désobéir et de changer d’organisation sociale. Les formes de
domination s’exercent par la violence, le contrôle de l’information et
le charisme.
Dans l’État moderne, ces trois formes de domination
se combinent d’une façon particulière, via la souveraineté
territoriale, la bureaucratie et les élections, mais cela n’avait rien
d’inéluctable (cette combinaison est d’ailleurs en train de se défaire,
mais pas dans le sens que nous désirons, pour se reconfigurer en de
grandes bureaucraties internationales sans souveraineté territoriale,
comme le FMI, la banque mondiale ou les grandes banques d’affaires). Au
cours de l’histoire, les différentes formes de domination se sont
combinées et recombinées de toutes sortes de façons. Elles ont souvent
été absentes et explicitement combattues, souvent l’une d’entre elles
s’exerçait de façon isolée, parfois elles se combinaient par deux. Les
chercheurs ont eu tendance à appeler « État », « structure étatique » ou
« proto-État » toutes les formes complexes d’organisation sociale dans
une logique parfaitement circulaire : est un État tout ce qui est
complexe, et vice versa, subsumant ainsi sous le même concept des modes
d’organisation très disparates. Ce regroupement artificiel entretenait
l’idée d’après laquelle une société étendue et complexe a nécessairement
besoin d’un gouvernement vertical doté de pouvoir coercitif, alors même
que les systèmes institutionnels les plus complexes ont souvent
précisément été ceux qui avaient pour fonction de lutter contre les
inégalités, la centralisation du pouvoir et de maintenir un processus de
décision démocratique.
Distinguer précisément les différentes
formes de domination et leur mode d’expression permet de tracer
d’inattendues et instructives analogies. À travers ce prisme, le système
électoral que nous connaissons n’apparaît plus comme l’essence de la
démocratie, mais comme son antithèse (une idée qui allait d’ailleurs de
soi jusqu’à la fin du XIXe siècle). Bien plus qu’aux assemblées
citoyennes et démocratiques de certaines villes mésopotamiennes, nos
élections s’apparentent à la « politique charismatique » en vigueur dans
les petits royaumes qui les entouraient, où les membres de
l’aristocratie dirigeante rivalisaient les uns avec les autres, à
travers toutes sortes de performances spectaculaires, pour solidifier
leur pouvoir. Le vote donne simplement le droit à la population
d’intervenir dans la compétition à grand spectacle qui départage des
personnages suffisamment bien nés pour pouvoir consacrer tout leur temps
à la politique.
Quant aux complexes processus administratifs,
que l’on associe aujourd’hui au terme dépréciatif de bureaucratie, leur
apparition semble avoir été plutôt guidée par des aspirations
égalitaires. Par exemple, entre environ – 6 000 et – 5 000, de vastes
réseaux de villages, dans une zone allant du sud de l’Iran à la Turquie,
se sont dotés d’outils administratifs conçus pour prévenir tout
déséquilibre de richesse et de statut. Cette fonction première de
l’administration s’inverse lorsqu’elle est capturée par des intérêts
privés : des institutions initialement pensées dans une logique de soin
deviennent des structures de domination (c’est ce qui finit par se
produire à Uruk). La bureaucratie contemporaine évoque moins les
systèmes administratifs à visée égalitaire des origines que des formes
de domination fondée sur la maîtrise de l’information, comme les
structures qui organisaient les savoirs ésotériques et les transes
hallucinatoires dans la société péruvienne de Chavín de Huántar.
Débloquer l’ordre social par la lutte territoriale
L’importance
des jeux de distinction dans l’histoire, c’est-à-dire la façon dont les
sociétés se sont construites et pensées par opposition les unes aux
autres, rappelle ce qui continue de se produire aujourd’hui à petite
échelle autour des territoires autonomes, du mouvement des ZAD, dans une
partie du monde associatif et sans doute dans de nombreux autres
endroits. On y tente en effet souvent de prendre le contre-pied de ce
qui se passe du côté de l’État : prise de décision au consensus, choix
politiques émancipés des logiques de profit, élaboration d’institutions
destinées à contenir l’importation et la reconstitution des différentes
formes de domination, relations non-utilitaristes avec les vivants
non-humains, etc. Ces expériences, qui tentent de retrouver un peu de
diversité et, donc, de revigorer les trois libertés fondamentales, sont
malheureusement beaucoup trop marginales. La question qui se pose est
alors de savoir comment, après tant d’expérimentations dans les derniers
millénaires, avons-nous pu nous retrouver bloqués dans une forme
d’organisation sociale aussi peu satisfaisante ? Et surtout : comment
nous débloquer ? Le livre ne donne pas de réponse, et on peut imaginer
que les trois autres volumes qui étaient prévus, et dont l’écriture a
été tragiquement interrompue par la mort de David Graeber, nous auraient
donné des pistes.
Risquons une modeste proposition de loi qui
irait dans le sens du déblocage. L’objectif est d’ouvrir des brèches sur
le territoire pour laisser émerger des modes d’existence fondés sur
d’autres logiques et ainsi créer plus d’hétérogénéité dans les
possibilités d’organisation sociale.
Aujourd’hui, lorsqu’une
occupation de terre de type ZAD se met en place, ou lorsque s’ouvre un
squat, les seules voies légales pour obtenir un délai avant l’expulsion
sont la trêve hivernale, la démonstration de très grande précarité ou de
l’impossibilité de se reloger. Il arrive que les occupant·es mettent en
valeur les vertus de leur projet, par comparaison avec celui envisagé
par le propriétaire, public ou privé, mais cela n’a de poids que dans le
cadre d’une éventuelle guerre médiatique. Légalement, la nature des
projets respectifs n’a aucune valeur. La proposition de loi consisterait
à rendre cette comparaison obligatoire et à conditionner à son résultat
l’éventualité d’une procédure d’expulsion. Ce serait une façon de
redonner la primauté au droit d’usage sur le droit de propriété.
La
comparaison pourrait être encadrée par des critères sociaux et
environnementaux relativement consensuels, que même le plus cynique des
entrepreneurs privés aurait du mal à récuser publiquement. Leur
application à chaque cas concret serait débattue par des assemblées,
prenant idéalement leurs décisions au consensus, et qui impliqueraient
tous les « co-affecté·es » par les projets. Par exemple, les habitant·es
du territoire, mais aussi tous ceux et celles qui ont des interactions
particulières avec les non-humains qui y vivent. On pourrait aussi
imaginer des clauses fonctionnant sur le principe de la trêve hivernale,
avec par exemple une obligation d’attendre les premières récoltes dans
le cas où les occupant·es auraient eu le temps de faire des semis. C’est
une loi qui rendrait l’État autophage : il se grignoterait lui-même.
Cela
nécessite d’être peaufiner… Mais l’idée est que l’on ne retrouvera les
trois libertés fondamentales de Graeber et Wengrow, notamment celle de
changer d’organisation sociale, qu’en parvenant à desserrer, sur
certains territoires, les mailles de l’État. Même pour les gens qui
n’ont aucune envie d’aller tenter l’expérience sur un territoire
autonome, rester du côté de l’État deviendrait une affaire de choix. Un
choix qui pourra à tout moment être remis en question, ce qui offrira à
la population une nouvelle arme dans le rapport de force avec les
classes dirigeantes et possédantes. Retrouver la possibilité de fuir
desserrera, par là même, l’étau économique dont l’État est devenu le
garant, ce qui est une condition nécessaire pour envisager de
transformer collectivement nos relations aux non-humains.
Cette
transformation, à laquelle beaucoup de gens appellent mais en omettant
généralement d’en énoncer les conditions, ne peut en effet se produire
dans un monde où l’exigence de rentabilité et les impératifs économiques
chapeautent l’ensemble de la vie politique et sociale. Les règles du
jeu économique imposent en effet de considérer collectivement les
non-humains comme des objets, que l’on exploite ou que l’on protège,
mais dans tous les cas que l’on utilise, et interdit de tenir compte de
leurs intérêts et de leurs perspectives.
Autrement dit, dans une
situation où les intérêts de l’État et ceux des grands acteurs de la
sphère économique sont aussi parfaitement superposés qu’ils le sont
aujourd’hui, la liberté de transformer nos relations aux non-humains est
conditionnée à la liberté de changer radicalement nos modes
d’organisation sociale. Il faut donc espérer que l’engouement – tout
relatif – pour l’anthropologie de la Nature3Cet intérêt se manifeste par
exemple dans le succès de Baptiste Morizot, Manières d’être vivant,
Actes Sud, 2020. qui peut rappeler par certains aspects le succès de la
critique indigène au début du XVIIIe siècle, se transforme rapidement en
une passion pour les perspectives de transformation sociale.
Cela
ne suffira sans doute pas à construire le rapport de force qui
permettrait de faire passer le projet de loi ci-dessus. Mais imaginons
que dans un futur proche les choses se mettent à tanguer vraiment, ce
qui est loin d’être exclu. Tanguer au point de faire réellement peur aux
classes dirigeantes et possédantes. Leurs membres s’adonneront de façon
prévisible à des comportements individualistes et survivalistes encore
plus spectaculaires et abjectes que ceux qu’ils pratiquent aujourd’hui,
pendant que les ZAD et tous les réseaux de solidarité locaux se
démèneront pour nourrir et loger la population. On peut cette fois
tracer un parallélisme avec la sortie de la deuxième guerre mondiale, et
se rappeler que les députés communistes sont parvenus à faire voter la
sécurité sociale entre autre parce que le grand patronat s’était
discrédité en faisant dans l’ensemble le choix de la collaboration
tandis que le Parti communiste était auréolée par l’aura de la
résistance. Une fenêtre politique pourrait donc, de la même manière,
s’ouvrir bientôt pour faire passer des lois squat/ZAD et droit d’usage.
Il
n’est pas difficile de trouver des objections à ce scénario, par
exemple en faisant valoir que les apprentis fascistes qui pullulent ne
le laisseront pas se dérouler sans rien faire. Mais reconnaissez qu’il
n’est pas évident ces temps-ci d’esquisser des perspectives optimistes.